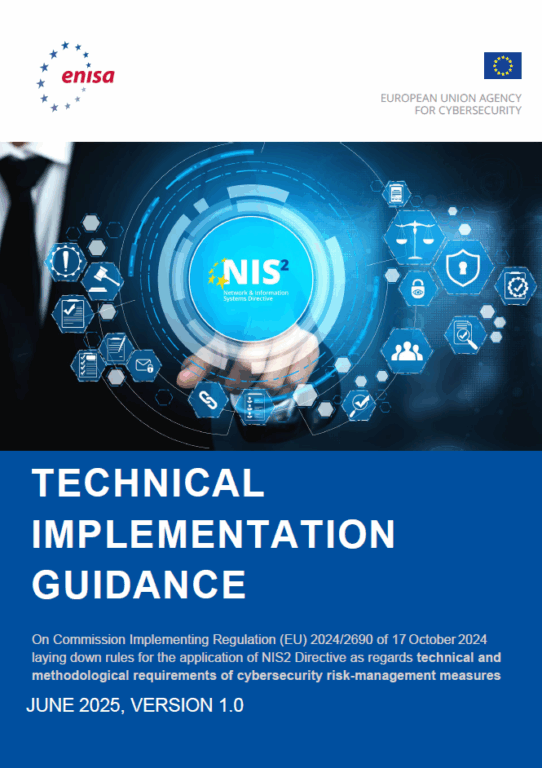4.1.1. Plan de Continuité des Activités (PCA) et de Reprise d’Activité (PRA)
4.1.1. Aux fins de l’article 21, paragraphe 2, point c), de la directive (UE) 2022/2555, les entités concernées établissent et maintiennent un Plan de Continuité des Activités (PCA) et de Reprise d’Activité (PRA) à appliquer en cas d’incident.
ORIENTATIONS
- Tenir compte des normes reconnues dans le secteur lors de l’élaboration du Plan de Continuité des Activités et du Plan de Reprise d’Activité.
- Dresser une liste des catastrophes naturelles (par exemple, ouragans, incendies, inondations) et autres événements (par exemple, erreurs humaines) susceptibles d’affecter les services, ainsi qu’une liste des capacités de reprise d’activité (par exemple, sauvegardes, tests, objectifs de reprise, etc.).
Commentaire Nuabee : il est extrêmement surprenant que dans la liste des risques à couvrir, il n’y ait pas les cyberattaques qui constituent aujourd’hui le risque majeur pour les entreprises.
EXEMPLES DE PREUVES
- Plan de Continuité des Activités.
- Plan de Reprise d’Activité.
- Les plans de continuité des activités et de reprise d’activité sont conformes aux normes documentées et/ou aux bonnes pratiques.
- Liste des catastrophes naturelles et/ou majeures susceptibles d’affecter les services et liste des capacités de reprise d’activité (disponibles en interne ou fournies par des tiers).
4.1.2. Plan de continuité opérationnel
4.1.2. Les opérations des entités concernées sont rétablies conformément au plan de continuité des activités et de reprise après sinistre.
Ce plan est fondé sur les résultats de l’évaluation des risques effectuée et comprend, le cas échéant, les éléments suivants :
- Objectif, champ d’application et destinataires
- Rôles et responsabilités
- Contacts clés et canaux de communication (internes et externes)
- Les conditions d’activation et de désactivation du plan ;
- L’ordre de reprise des activités ;
- Les plans de reprise pour des activités spécifiques, y compris les objectifs de reprise ;
- Les ressources nécessaires, y compris les sauvegardes et les redondances ;
- La reprise et la relance des activités à partir de mesures temporaires.
Conseils
- Conserver des registres de l’activation et de l’exécution du plan de continuité des activités, y compris :
- Les décisions prises ;
- Les mesures suivies et le délai de reprise final.
- Déterminer l’ordre de reprise sur la base de critères, notamment (liste indicative et non exhaustive) :
- Le niveau de classification des actifs ;
- L’importance du service pour l’entité ;
- Les dépendances (les services ou actifs essentiels pour d’autres sont repris en premier) ;
- Les objectifs de reprise (annexe du règlement, point 4.1.3) ;
- La disponibilité des ressources ;
- Les exigences réglementaires.
- Réaliser une planification des capacités afin que les capacités nécessaires au traitement de l’information, aux télécommunications et au support environnemental soient disponibles après l’activation du plan de continuité d’activité.
- Envisager des fournisseurs de services de télécommunications principaux et alternatifs, section 13.1, afin de maintenir correctement les plans de reprise d’activité (pour les services fournis).
- Pour le travail à distance, les employés chargés des opérations critiques doivent :
- Avoir accès à des solutions Internet de secours (par exemple, haut débit mobile, capacités de partage de connexion)
- Participer à des tests réguliers des options de basculement, y compris l’accès VPN et les communications vocales (par exemple, VoIP ou téléphonie Cloud) sur les réseaux de secours.
- Préparer la reprise et la restauration des services après une catastrophe en identifiant des mesures telles que :
- Des sites de basculement dans d’autres régions ;
- Des sauvegardes des données critiques vers des sites distants ; et
- Des procédures de restauration testées avec des cycles de validation réguliers.
- S’assurer que des services tiers (par exemple, un site de secours) seront disponibles en cas de sinistre, le cas échéant.
- Mettre en œuvre des mesures avancées pour les capacités de reprise après sinistre, le cas échéant, par exemple :
- Une redondance complète ;
- Des mécanismes de basculement ;
- Un site alternatif.
EXEMPLES DE PREUVES
- Mesures en place pour faire face aux catastrophes, telles que des sites de basculement dans d’autres régions et des sauvegardes de données vers des sites distants.
- Structures organisationnelles à jour largement communiquées.
- Inventaire des secteurs et services essentiels à la continuité du réseau et du fonctionnement des services et/ou dépendants de ceux-ci, et plans d’urgence pour atténuer l’impact sur les secteurs et services dépendants et interdépendants.
Commentaire Nuabee : toujours mêmes lacunes sur les sujets de cyberattaque et de nécessité de cyber-résilience.
4.1.3. Analyse d’impact sur l’activité
4.1.3. Les entités concernées effectuent une analyse d’impact sur l’activité afin d’évaluer l’impact potentiel de perturbations graves sur leurs activités et établissent, sur la base des résultats de cette analyse, des exigences de continuité pour les réseaux et les systèmes d’information.
GUIDE
- Sur la base des résultats de l’analyse d’impact sur les activités (36) et de l’évaluation des risques, l’entité doit définir des objectifs de reprise appropriés, visés au point 4.1.2, point f), de l’annexe du règlement (liste indicative et non exhaustive) :
- Objectifs de temps de reprise (RTO) afin de déterminer le délai maximal autorisé pour la reprise des ressources et des fonctions opérationnelles (par exemple, les systèmes et processus des technologies de l’information et de la communication (TIC) et des processus, respectivement) après la survenue d’un sinistre, par exemple le temps d’indisponibilité maximal du site web, du système de planification des ressources de l’entreprise (ERP) ou du système de messagerie électronique de l’entité.
- Objectif de point de reprise (RPO) pour déterminer la quantité de données qu’il est acceptable de perdre pour des activités ou des applications TIC spécifiques
- Ils sont généralement mesurés en temps maximum nécessaire pour récupérer les données sans causer de dommages inacceptables, selon l’évaluation des risques, aux activités de l’entité, par exemple le temps de reprise maximal pour un site web de commerce électronique, un système ERP ou un serveur de messagerie électronique.
- Objectif de prestation de services (SDO) pour déterminer le niveau de performance minimal qui doit être atteint par les fonctions commerciales pendant le mode de traitement alternatif. Une liste indicative et non exhaustive d’exemples comprend :
- Le pourcentage d’appels entrants auxquels un centre d’appels doit répondre dans un délai spécifique
- Le niveau de disponibilité des systèmes de commande et de paiement d’un site web de commerce électronique dans un délai spécifique ;
- Le temps de restauration pour accéder aux dossiers partagés essentiels via un système d’accès aux fichiers dans le cloud ; et
- Le délai dans lequel l’ensemble des fonctionnalités de l’infrastructure de travail à distance est rétabli.
- Interruption maximale Acceptable (MAO : Maximum Acceptable Outage) ou période maximale de perturbation tolérable (MTPD : maximum tolerable period of disruption) pour déterminer le temps nécessaire pour que les impacts potentiels de la non-fourniture d’un produit/service ou de la non-exécution d’une activité deviennent inacceptables ou significatifs, conformément à l’évaluation des risques
- Ils sont généralement plus longs que les RTO. Les MAO se concentrent sur la disponibilité des services, tandis que les RPO se concentrent sur la perte de données. Voici une liste indicative et non exhaustive d’exemples :
- La période au-delà de laquelle le service à la clientèle serait gravement affecté et le risque de réputation augmenterait rapidement ;
- La période la plus longue pendant laquelle une interruption prolongée d’un site web de commerce électronique pourrait entraîner une perte importante de ventes et de confiance des clients ;
- La période la plus longue pendant laquelle l’accès partagé aux fichiers du projet peut interrompre la collaboration ou la prise de décision dans le cas où les données sont stockées dans le cloud ; et
- L’interruption maximale acceptable pour l’infrastructure de travail à distance au-delà de laquelle les fonctions commerciales sont considérablement perturbées et les pertes de productivité commencent à s’aggraver.
Les RTO, RPO et SDO peuvent être utilisés pour déterminer les procédures de sauvegarde et de redondance.
- Les RTO, RPO et SDO peuvent être utilisés pour déterminer les procédures de sauvegarde et de redondance.
- Documenter le Plan de Reprise d’Activité en tenant compte :
- Des RTO, RPO et SDO ; et
- De la conformité avec les réglementations et législations applicables.
Commentaire Nuabee : toujours mêmes lacunes sur les sujets de cyberattaque et de nécessité de cyber-résilience. Le RTO n’est pas un bon indicateur dans des contextes de cyberattaque, mais plutôt la profondeur de sauvegarde, l’étanchéité des environnements, ….
EXEMPLES DE PREUVES
- Analyse d’impact sur les activités documentée avec des objectifs de reprise spécifiques.
- Processus, procédures et mesures visant à garantir le niveau de continuité requis dans des situations perturbatrices.
4.1.4. Test et mise à jour du PCA et du PRA
4.1.4. Le plan de continuité des activités et le Plan de Reprise d’Activité doivent être testés, revus et, le cas échéant, mis à jour à intervalles réguliers et à la suite d’incidents importants ou de changements significatifs dans les opérations ou les risques. Les entités concernées doivent veiller à ce que les plans intègrent les enseignements tirés de ces tests.
GUIDANCE
- Tester, réviser et, si nécessaire, mettre à jour les plans de continuité des activités et de reprise d’activité au moins une fois par an.
- Choisir et combiner une ou plusieurs méthodes pour tester les plans de continuité des activités et de reprise après sinistre, telles que :
- Des sites alternatifs pour le personnel ;
- Des sites de reprise après sinistre – sites de secours ;
- Des jumeaux numériques ;
- Des simulations ;
- Des exercices sur table.
- Tester régulièrement les plans de continuité des activités et de reprise après sinistre, en tenant compte :
- Des journaux des modifications ;
- Des incidents passés ; et
- Des résultats des tests précédents.
- Le cas échéant, tester le Plan de Reprise d’Activité sur un site de traitement alternatif afin de :
- Familiariser le personnel concerné avec les installations et les ressources disponibles ; et
- Évaluer les capacités du site de traitement alternatif à prendre en charge les opérations.
- Tester l’infrastructure du datacenter pour vérifier :
- La disponibilité ;
- Le basculement automatique ;
- Le basculement entre les fournisseurs d’alimentation et/ou entre les fournisseurs d’alimentation et les systèmes de secours (par exemple les générateurs ou les batteries) ; et la résilience nécessaire pour maintenir le service aux clients.
- Définir la reprise complète et la reconstitution du système d’information dans un état connu dans le cadre des tests du Plan de Reprise d’Activité.
- Mettre à jour les plans de continuité des activités et de reprise d’activité et les mesures connexes en fonction :
- Des journaux des modifications ;
- Des incidents passés ;
- Des registres des activités de formation individuelles.
- Examiner les journaux des modifications et les résultats documentés des tests antérieurs sur les plans de continuité des activités et de reprise après sinistre afin de s’assurer que les plans intègrent les enseignements tirés de ces tests.
- Examiner et, si nécessaire, mettre à jour les rôles et responsabilités.
GUIDE DE MISE EN ŒUVRE TECHNIQUE
- Examiner les plans de reprise après sinistre des tiers dépendants afin de s’assurer que ces plans répondent aux exigences de continuité des activités de l’entité.
- Communiquer les modifications apportées aux plans de continuité des activités et de reprise après sinistre aux membres clés du personnel concernés.
- Communiquer les modifications apportées aux plans de continuité des activités et de reprise après sinistre au personnel clé concerné.
EXEMPLES DE PREUVES
- Plans ou calendriers documentés pour les tests futurs.
- Registres des tests, examens et mises à jour éventuelles antérieurs.
- Registres d’activation et d’exécution des plans de continuité des activités et de reprise après sinistre, y compris les décisions prises, les mesures suivies et le délai de reprise final.
- Communications, par exemple courriels, documents et annonces sur l’intranet, concernant les modifications apportées aux plans de continuité des activités et de reprise d’activité.
- Preuves que les enseignements tirés des tests antérieurs sont intégrés dans les plans, par exemple modifications du flux de travail et plans actualisés.
CONSEILS
- Outre les éléments visés au point 4.1.2 de l’annexe du règlement, le plan de continuité des activités peut porter sur les aspects suivants :
- L’engagement de la direction ;
- La coordination entre les unités organisationnelles ;
- Le plan de communication ;
- Le respect des lois ;
- Les indicateurs permettant de mesurer la mise en œuvre réussie du plan.
- Protéger les plans de continuité des activités et de reprise après sinistre contre toute divulgation et modification non autorisées.
- Veiller à ce que les plans de continuité des activités et de reprise après sinistre soient facilement accessibles en cas de panne du système. Voici une liste indicative et non exhaustive d’options pour y parvenir :
- Copies physiques ;
- Stockage dans le cloud ;
- Disques externes ;
- Accès mobile.
- Distribuer des copies du plan de continuité des activités au personnel clé concerné.
- Surveiller l’activation et l’exécution du plan de continuité des activités en enregistrant les délais de reprise réussis et échoués.
- Ajouter une référence ou une description/un lien vers la politique, le plan et les procédures de gestion des incidents dans le plan de continuité des activités.
- Coordonner le plan de continuité des activités avec les plans respectifs des prestataires de services externes afin de garantir le respect des exigences en matière de continuité
- Former le personnel clé impliqué dans les opérations de continuité.
- Mettre en place des procédures concernant les canaux de communication appropriés avec les autorités (inter)nationales compétentes, y compris les organisations de gestion des catastrophes et les équipes de secours.
- Former régulièrement le personnel responsable des opérations de reprise après sinistre.
- Mettre en œuvre des plans d’urgence pour les systèmes basés sur des scénarios.
- Surveiller l’activation et l’exécution des plans d’urgence, en enregistrant les RTO, RPO et SDO réussis et échoués.
- Mettre en œuvre des plans d’urgence pour les secteurs et services hautement critiques et interdépendants.
EXEMPLES DE PREUVES
- Mesures, par exemple le chiffrement et le contrôle d’accès, pour protéger la continuité des activités et les plans de reprise d’activité contre la divulgation et la modification non autorisées.
- Structures organisationnelles à jour largement communiquées.
- Processus décisionnel pour l’activation des plans d’urgence.
- Plans d’urgence pour les systèmes, comprenant des étapes et des procédures claires pour les menaces courantes, les déclencheurs d’activation, les étapes et les RTO, RPO et SDO définis.
- Registres de l’activation et de l’exécution des plans d’urgence, y compris les décisions prises, les étapes suivies et le temps de reprise final.